Mis à jour le 31 juillet 2025 Dr Béatrice GUYARD BOILEAU
69% des parents ont trouvé cet article utile.

Le cytomégalovirus (CMV) est un virus fréquent, appartenant à la famille des Herpesviridae. Chez la majorité des adultes en bonne santé, l’infection passe inaperçue. Pourtant, le CMV peut avoir des conséquences graves s’il est contracté juste avant la grossesse, ou dans les premiers mois de celle-ci .
Face à ce risque, le Haut Conseil de la santé Publique[1] en décembre 2023 et la Haute Autorité de Santé (HAS)[2] en juin 2025 ont actualisés les informations disponibles et les recommandations pour améliorer la prévention, le dépistage et la prise en charge du CMV pendant la grossesse et renforcer les mesures de prévention chez les femmes enceintes, en particulier celles non immunisées.
Écouter l'article
0:00 / 0:00Sommaire de l'article
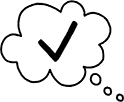
Je retiens !
Le cytomégalovirus (CMV) est un virus fréquent et souvent inoffensif, mais il peut avoir des conséquences graves pendant la grossesse, tout particulièrement au début de celle-çi.
Les femmes enceintes non immunisées ou d’immunité inconnue peuvent bénéficier du dépistage de cette infection par une prise de sang au premier trimestre de la grossesse. La mise en place de mesure simple de prévention est recommandée, notamment chez les femmes enceintes en contact avec de jeunes enfants.
Afin de réduire les risques de contamination, des gestes d’hygiène rigoureux et réguliers doivent être adoptés par la femme enceinte, mais aussi par le conjoint ou le co-parent. Parmi les précautions à adopter au quotidien :
-
éviter d’embrasser les jeunes enfants sur la bouche ou les joues ;
-
ne pas partager les couverts, verres ou brosses à dents ;
-
se laver les mains fréquemment, surtout après avoir changé une couche, mouché un enfant ou manipulé des jouets mis à la bouche.
Grâce à ces gestes d’hygiène simples et le plus réguliers possibles, il est possible de réduire significativement les risques de contamination. En cas de suspicion d’infection ou de signes évocateurs à l’échographie, une prise en charge spécialisée permet de poser un diagnostic et d’envisager, dans certains cas, un traitement antiviral.
Qu’est-ce que le cytomégalovirus ?
Un virus fréquent mais souvent méconnu
Le cytomégalovirus (CMV) est un virus à ADN, c’est-à-dire qu’une fois contracté, il reste présent dans l’organisme à vie, sous une forme latente pouvant se réactiver en cas de baisse des défenses immunitaires.
L’infection à CMV est très répandue : environ 50 à 70 % des adultes français sont porteurs du virus à l’âge adulte, souvent sans le savoir[1]. La majorité des infections sont asymptomatiques ou responsables de symptômes bénins tels que la fatigue, fièvre modérée, douleurs musculaires ou maux de gorge.
Pourtant, si le virus est généralement sans danger chez les personnes en bonne santé, il peut se révéler particulièrement dangereux chez les fœtus en cas d’infection pendant la grossesse, ainsi que chez les nouveau-nés prématurés ou les personnes immunodéprimées.
Pour en savoir plus sur le cytomégalovirus, vous pouvez visionner la vidéo « Le cytomégalovirus : c’est quoi ? » réalisée par Tuto’Tour de la Grossesse.
Le cytomégalovirus : c’est quoi ?
Modes de transmission du CMV
Le cytomégalovirus se transmet par contact direct et répété avec des fluides corporels infectés tels que :
- la salive ; les larmes ;
- les urines ; les selles et autres sécrétions ;
- le sang ;
- les sécrétions génitales ; le sperme ;
- le lait maternel.
Le partage de couverts ou de la nourriture des jeunes enfants, les changes de couches ou encore les baisers sur la bouche sont des circonstances de contamination potentielle, en particulier dans un cadre familial ou professionnel si on travaille au contact de jeunes enfants.
Chez la femme enceinte, la transmission au fœtus peut survenir à tout moment de la grossesse, en cas de première infection (encore appelée infection primaire), de réinfection par une autre souche, ou de réactivation du virus. On parle alors de CMV congénital. La contamination peut aussi se produire après la naissance, par exemple via l’allaitement ou une transfusion sanguine.
Les enfants en bas âge, notamment ceux accueillis en crèche, constituent un réservoir important du virus, qu’ils excrètent dans leur salive et leurs urines pendant plusieurs mois après l’infection. C’est pourquoi les jeunes enfants représentent une source majeure d’exposition pour les femmes enceintes si celles-ci ne sont pas immunisées.
Il est important que le conjoint des femmes enceintes se protège également et applique ces mesures simples. Ainsi ; il évitera d’être contaminé par le CMV, et de donc potentiellement de pouvoir le transmettre à sa conjointe enceinte.
Infection à CMV : symptômes et évolution
Chez l’adulte sain : une infection souvent silencieuse
Chez les personnes en bonne santé, une infection à cytomégalovirus (CMV) passe souvent inaperçue. On estime que dans 70 à 90 % des cas, l’infection est asymptomatique[1].
Lorsque des symptômes apparaissent, on peut constater :
- une fièvre modérée ;
- une fatigue prolongée ;
- des maux de tête ;
- des douleurs musculaires ou articulaires ;
- des ganglions enflés ;
- et parfois une légère inflammation du foie (hépatite).
Dans la majorité des cas, ces signes restent bénins et transitoires, ce qui rend l’infection difficile à identifier sans prise de sang (test sérologique).
Chez le fœtus et le nouveau-né : des conséquences graves possibles
Le CMV congénital, transmis in utero, est la première cause d’infection virale congénitale en France ; on estime qu’une naissance sur 200 est concernée[2].
Parmi ces nourrissons infectés :
- environ 10 à 15 % présentent des symptômes à la naissance,
- et 30 à 50 % des enfants symptomatiques garderont des séquelles durables[2].
Les manifestations cliniques possibles chez le nouveau-né comprennent un.e :
- retard de croissance intra-utérin ;
- ictère (anomalie de la coloration (jaunâtre) de la peau et des muqueuses) ;
- purpura (affection cutanée caractérisée par l’apparition de taches rouges ou violettes sur la peau) ;
- hépatosplénomégalie (augmentation simultanée du volume du foie et de la rate) ;
- microcéphalie(tête qui cesse de se développer après la naissance) ;
- trouble auditif, visuel, ou neurologique.
Même les enfants asymptomatiques à la naissance peuvent développer des troubles auditifs ou neurosensoriels dans les premières années de vie, d’où l’importance d’un suivi médical prolongé après une infection congénitale.
Pour en savoir plus sur les conséquences du cytomégalovirus, vous pouvez visionner la vidéo « Conséquences du cytomégalovirus » réalisée par Tuto’Tour de la Grossesse.
Conséquences du cytomégalovirus
Dépistage et diagnostic du CMV
Quand et pourquoi dépister une femme enceinte ?
Comme la toxoplasmose ou la rubéole, le dépistage systématique du cytomégalovirus (CMV) pendant la grossesse est devenu recommandé en France[2], pour une durée expérimental de trois années durant laquelle des évaluations complémentaires seront conduites.
L’interprétation des prises de sang vis-à-vis du CMV est néanmoins complexe. Dans certains cas, il existera un doute sur la possibilité d’une infection, par le CMV. Cette incertitude quant à l’existence réelle d’une infection à CMV peut générer une inquiétude chez les femmes enceintes.
Sérologie et prise de sang
Le diagnostic d’une infection à cytomégalovirus (CMV) repose d’abord sur une prise de sang permettant de réaliser une sérologie CMV, qui recherche la présence d’anticorps IgG et IgM. Cette prise de sang de grossesse est recommandée au premier trimestre de la grossesse. Par la suite il n’est pas nécessaire de réaliser d’autres prises de sang. En effet en cas de contamination après le premier trimestre que le risque paraît beaucoup plus faible.
Cette prise de sang recherche les anticorps contre le CMV, appelés IgG et IgM.
- Si les IgG sont présents, ils indiquent une immunité : la personne a été exposée au virus dans le passé. Pour préciser la date de cette infection, on mesure alors ce qu’on appelle l’avidité des IgG, parfois, en particulier en cas de présence d’IgM ou de sérologie tardive dans la grossesse. Une forte avidité suggère que l’infection est ancienne (généralement plus de 4 mois). Par un calcul entre la date de la prise de sang et la date du début de grossesse, on peut estimer si l’infection date d’avant la grossesse, et être ainsi rassuré quant à l’absence d’infection primaire au début de la grossesse.
- Si les IgM sont présents, cela peut traduire une infection récente, surtout si ils sont associés à des IgG. Mais des IgM peuvent également être présents en lien avec d’autres virus ou infections récentes, sans lien avec le CMV. On nomme cela des « faux positifs » pour le CMV. La présence d’IgM seul ne permet pas donc de conclure à une infection récente par le CMV. En effet, elles peuvent être présentes alors que l’infection est ancienne ou encore de nombreuses autres causes.
- Des centres dits « de référence » sont parfois sollicités pour aider à l’interprétation des résultats de la prise de sang. D’autres prises de sang sont parfois demandées . Néanmoins, dans certains cas, il ne sera pas possible de conclure avec certitude. Les équipes médicales adapteront la surveillance et la prise en charge.
Échographie et amniocentèse en cas de suspicion fœtale
Lorsqu’un dépistage maternel est positif ou que des anomalies échographiques sont observées, des examens complémentaires sont proposés :
- une échographie fœtale spécialisée pour détecter d’éventuelles anomalies liées au CMV ;
- une amniocentèse, généralement réalisée au moins 8 semaines après l’infection maternelle présumée et après 21 semaines d’aménorrhée, pour rechercher la présence du virus dans le liquide amniotique (PCR CMV).
Dépistage du CMV à la naissance
Un test salivaire ou urinaire chez le nouveau-né dans les 21 premiers jours de vie permet de poser le diagnostic de CMV congénital.
Quel traitement en cas d’infection à CMV ?
Chez la femme enceinte : un encadrement médical, et un traitement par antiviral en comprimé.
Dans certains cas bien définis, et selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé en juin 2025, un traitement par antiviraux en comprimés (valaciclovir) peut être envisagé. Il s’adresse uniquement aux femmes enceintes ayant contracté une infection primaire récente avec un risque avéré de transmission fœtale. Ce traitement, initié sous strict contrôle médical, vise à réduire le taux de transmission du virus au fœtus. Son usage reste limité à des centres spécialisés, en lien avec un service de diagnostic anténatal.
Par ailleurs, un suivi échographique rapproché est systématiquement mis en place afin de surveiller l’évolution du fœtus, notamment la croissance, le développement cérébral et d’éventuelles anomalies. Parfois, une IRM cérébrale fœtale est proposée par les équipes médicales.
Chez le nouveau-né infecté : un traitement possible dans les formes symptomatiques ?
Chez le nouveau-né atteint de CMV congénital avec symptômes cliniques, un traitement antiviral peut être proposé par les équipes médicales, selon l’ évaluation clinique de l’enfant. Le plus souvent, il s’agit de valganciclovir, un antiviral, administré par voie orale pendant plusieurs semaines. Ce traitement a pour objectif de limiter les séquelles neurologiques et auditives à long terme.
Un suivi médical multidisciplinaire est ensuite organisé pour évaluer l’évolution de l’enfant, notamment sur le plan auditif, moteur et cognitif.
Prévention de l’infection à cytomégalovirus : gestes clés pour les femmes enceintes
Dans l’attente d’un vaccin, la seule façon efficace de se protéger contre le cytomégalovirus (CMV) pendant la grossesse repose sur des mesures simples, visant à se protéger des sécrétions, tout particulièrement des jeunes enfants.
La Haute Autorité de Santé[2] recommande une application rigoureuse de plusieurs gestes simples mais très efficaces pour limiter la transmission du virus.
Les femmes enceintes (ou souhaitant l’être) et leur conjoint doivent notamment se laver soigneusement les mains à l’eau et au savon pendant au moins 30 secondes, surtout après avoir :
- changé une couche ;
- mouché un enfant ;
- manipulé des jouets portés à la bouche ;
- ou avant de manger ou de préparer les repas.
Il est également conseillé d’éviter d’embrasser les jeunes enfants sur la bouche, de ne pas partager les couverts, verres et les restes des repas ou brosses à dents, et de nettoyer le plus régulièrement possible les surfaces en contact avec la salive ou l’urine (comme les tables à langer, table du repas).
Ces gestes de prévention sont une méthode efficace pour réduire le risque de contamination pendant la grossesse. L’enjeu est important : une infection évitée, c’est autant de risques de séquelles pour le futur bébé qui sont écartés.
Pour en savoir plus les mesures de prévention du cytomégalovirus, vous pouvez visionner la vidéo « Cytomégalovirus : comment réduire les risques » réalisée par Tuto’Tour de la Grossesse.
Cytomégalovirus : comment réduire les risques
Cet article vous a-t-il été utile ?
mpedia vous a aidé, aidez mpedia en faisant un don
Dernier don de Marie : 2 €
Comme Marie, soutenez une expertise indépendante et reconnue pour continuer à être un parent bien informé.
[1] HCSP Dépistage systématique de l’infection à cytomégalovirus pendant la grossesse
Haut Conseil de la Santé Publique. Dépistage systématique de l’infection à cytomégalovirus pendant la grossesse.
Haut Conseil de la Santé Publique. La prévention de l’infection à cytomégalovirus chez la femme enceinte et chez le nouveau-né.
Note :
Les liens hypertextes menant vers d’autres sites ne sont pas mis à jour de façon continue. Il est donc possible qu’un lien devienne introuvable. Dans un tel cas, utilisez les outils de recherche pour retrouver l’information désirée.
Vous pouvez aussi être intéressé.e par :
Des conseils adaptés à l’âge de votre enfant !
Je m'abonne à la newsletterVous ne trouvez pas de réponse à votre question ?
Vous pouvez consulter les réponses déjà apportées par nos médecins à ce sujet en tapant votre question ou mots clés dans le moteur de recherche ci-dessous
Toujours pas de réponse ? Posez votre question à l'un de nos experts qui vous répondra rapidement.
Je pose ma questionPlus que 3 questions disponibles aujourd’hui
















