Mis à jour le 15 septembre 2025 Dr Myrna ACHKAR
100% des parents ont trouvé cet article utile.

Certains enfants semblent réagir plus fortement que d’autres aux bruits, aux changements, aux émotions ou aux conflits. Ils pleurent facilement, posent beaucoup de questions ou se montrent extrêmement attentifs aux autres. Il se pourrait qu’ils soient hypersensibles. Ce trait de personnalité, encore méconnu ou confondu avec des troubles du comportement, concerne environ 15 à 20 % des enfants, selon la psychologue américaine Elaine N. Aron, pionnière dans l’étude de l’hypersensibilité1.
Écouter l'article
0:00 / 0:00Sommaire de l'article
Qu’est-ce que l’hypersensibilité ?
L’hypersensibilité désigne une tendance à ressentir les émotions, les sensations ou les stimuli de manière plus intense que la moyenne. Il ne s’agit pas d’un trouble psychologique, mais d’un trait de personnalité stable, observable dès la petite enfance. L’enfant hypersensible perçoit plus intensément les signaux de son environnement, ce qui peut le rendre à la fois très réactif, créatif, mais aussi parfois vulnérable au stress ou au surmenage émotionnel.
Hypersensibilité, hyperémotivité, sensibilité élevée : de quoi parle-t-on exactement ?
Il est important de distinguer l’hypersensibilité de la simple sensibilité ou de l’hyperémotivité.
- La sensibilité est une caractéristique universelle : tout le monde est sensible, mais à des degrés différents.
- L’hyperémotivité désigne une réactivité émotionnelle forte, parfois excessive, souvent passagère ou liée à un contexte spécifique (fatigue, anxiété, etc.).
- L’hypersensibilité, elle, regroupe une sensibilité émotionnelle, mais aussi sensorielle, cognitive et relationnelle : les émotions sont intenses, mais l’enfant est aussi plus sensible aux sons, lumières, odeurs, changements ou tensions dans l’environnement.
Ce concept a été théorisé dans les années 1990 par la psychologue américaine Elaine N. Aron, qui parle de Highly Sensitive Person (HSP). Elle estime qu’environ 15 à 20 % de la population présente ce profil. Cette proportion se retrouve également chez les enfants2.
Les différentes formes d’hypersensibilité
Chez les enfants, l’hypersensibilité peut se manifester de plusieurs manières :
- hypersensibilité sensorielle : bruit, lumière, textures des vêtements, goûts, etc. ;
- hypersensibilité émotionnelle : émotions très intenses, empathie exacerbée ;
- hypersensibilité environnementale : difficulté à gérer les changements, les imprévus ou les tensions ;
- hypersensibilité cognitive : suranalyse, imagination débordante, tendance à s’inquiéter facilement.
Un même enfant peut cumuler plusieurs de ces dimensions. Cela explique pourquoi certains enfants paraissent « à fleur de peau », fatigués ou agités sans raison apparente.
Quelles sont les causes de l’hypersensibilité ?
Une base biologique et neurologique
Des études en neuropsychologie5 ont montré que les personnes hypersensibles présentent une activité cérébrale accrue dans certaines zones du cerveau, notamment dans les régions associées à la perception sensorielle, à l’empathie et au traitement émotionnel.
Par exemple, une étude menée par Acevedo et al. (2014) 5, en imagerie cérébrale, a mis en évidence une activation plus importante du système d’empathie chez les personnes hypersensibles lorsqu’elles observaient des expressions faciales ou des situations émotionnelles.
Ce fonctionnement serait en partie inné : l’hypersensibilité serait un trait de tempérament, avec une composante génétique. Selon Elaine N. Aron, ce trait aurait un rôle adaptatif : dans certains environnements, être plus attentif aux détails ou aux dangers a pu favoriser la survie1.
Le rôle de l’environnement et de l’éducation
Si la base est en grande partie biologique, l’environnement dans lequel évolue l’enfant joue un rôle clé dans l’expression ou le développement de son hypersensibilité3.
- Un cadre trop stimulant ou imprévisible (bruit, stress familial, rythme accéléré) peut épuiser un enfant hypersensible.
- À l’inverse, un environnement stable, rassurant et soutenant lui permet souvent de mieux gérer ses émotions et ses perceptions.
- L’attitude des adultes est déterminante : un enfant hypersensible qui se sent compris développera plus facilement une bonne estime de soi.
Enfin, l’hypersensibilité peut coexister avec d’autres particularités : haut potentiel intellectuel, troubles de l’attention (TDAH), ou troubles du spectre autistique (TSA). Il est donc essentiel de ne pas confondre l’hypersensibilité avec un trouble du développement.
Comment reconnaître un enfant hypersensible ?
Identifier l’hypersensibilité chez un enfant peut être délicat, car ses manifestations varient d’un enfant à l’autre. Pourtant, il existe des caractéristiques récurrentes qui permettent aux parents et aux professionnels de repérer un profil hypersensible.
Des signes observables dans le quotidien
Les enfants hypersensibles présentent souvent une série de comportements caractéristiques qui peuvent se manifester dès le plus jeune âge.
Ils réagissent fortement aux critiques ou aux remarques, pleurent facilement et expriment leurs émotions de façon intense. Très attentifs aux détails de leur environnement, ils sont particulièrement sensibles aux sons, aux odeurs, aux lumières ou aux textures. Ces enfants peuvent se sentir rapidement submergés dans un environnement bruyant ou changeant et ont tendance à s’inquiéter facilement, anticipant souvent les problèmes.
Ils font preuve d’une grande empathie, allant spontanément vers les autres pour les consoler ou capter leurs émotions, et sont très affectés par les injustices ou les conflits. Souvent, ils ont besoin de moments de solitude pour se ressourcer, posent des questions profondes et montrent une sensibilité marquée à l’art, à la nature ou à la beauté.
Leur imagination est riche, parfois débordante et ils tolèrent difficilement la pression ou la compétition. Enfin, les transitions comme un changement d’activité, un déménagement ou une rentrée scolaire peuvent générer chez eux une forte insécurité.
Si un ou deux de ces signes peuvent simplement refléter un tempérament sensible, leur accumulation et leur persistance dans le temps peuvent orienter vers un profil hypersensible, comme l’a décrit Elaine N. Aron2.
Hypersensibilité ou troubles du comportement : comment faire la différence ?
Il arrive fréquemment que des enfants hypersensibles soient mal compris et perçus comme « difficiles », capricieux ou même hyperactifs. Pourtant, leur comportement ne traduit pas un refus d’obéir, mais bien souvent une surcharge émotionnelle ou sensorielle qu’ils ne savent pas encore exprimer autrement.
Contrairement aux troubles du comportement, qui impliquent souvent des conduites répétées de transgression ou d’opposition active, l’enfant hypersensible peut se calmer avec un environnement stable, une écoute attentive et des repères clairs. Là où un enfant présentant un trouble du comportement agit sans tenir compte des conséquences, refuse l’autorité ou nécessite un suivi pluridisciplinaire.
En cas de doute, ou si l’enfant montre des signes de souffrance, il est recommandé de consulter un psychologue pour enfant ou un pédopsychiatre afin de poser un diagnostic différentiel fiable et d’éviter une confusion avec d’autres profils.
Quelles conséquences dans la vie quotidienne ?
À l’école : surcharge sensorielle et difficulté à s’adapter
L’environnement scolaire, souvent stimulant et bruyant, peut représenter un vrai défi pour l’enfant hypersensible. Il peut se sentir débordé par les bruits de la classe, les sollicitations multiples, les changements de rythme ou les consignes vagues. Certains enfants deviennent discrets, anxieux, voire effacés ; d’autres peuvent montrer des signes d’agitation ou de repli. Dans certains cas, la surcharge émotionnelle peut entraîner un refus scolaire anxieux.
Conséquences sur la santé mentale
Si l’hypersensibilité est mal comprise, elle peut fragiliser l’estime de soi de l’enfant, qui se sentira « trop » ou « pas comme les autres ». Cela augmente le risque de troubles associés tels que l’anxiété, le stress chronique, la phobie scolaire, voire la dépression à l’adolescence4. L’hypersensibilité n’est pas une maladie, mais elle rend l’enfant plus vulnérable si son environnement n’est pas suffisamment bienveillant.
Une richesse… mal canalisée
Il est important de rappeler que l’hypersensibilité n’est pas uniquement un facteur de fragilité. C’est aussi un fonctionnement riche, associé à de grandes qualités : créativité, lucidité émotionnelle, intuition, conscience aiguë de soi et des autres. Mais sans accompagnement, ces forces peuvent devenir des sources d’angoisse. C’est pourquoi une approche préventive et éducative est essentielle pour aider l’enfant à développer des stratégies de régulation et à s’épanouir.
Comment accompagner un enfant hypersensible ?
Accueillir et valider ses émotions
Un enfant hypersensible ressent plus intensément les émotions, mais cela ne signifie pas qu’il « exagère » ou qu’il est « trop émotif ». Lui dire : « Tu es trop sensible » ou « Ce n’est rien, arrête de pleurer » peut renforcer son sentiment de décalage. Il est préférable de mettre des mots sur ce qu’il ressent : « Tu es déçu parce que le jeu s’est arrêté, je comprends ». Cette validation émotionnelle l’aide à se sentir compris, à nommer ses ressentis et à commencer à les réguler1.
Instaurer un cadre rassurant et prévisible
Si tous les enfants se sentent en sécurité dans un environnement stable, avec des repères clairs et peu de surprises, c’est d’autant plus important pour les enfants hypersensibles. Cela passe par :
- des routines (heures fixes pour les repas, le coucher, etc.) ;
- des transitions préparées (prévenir d’un changement ou d’un déplacement à l’avance) ;
- un rythme adapté, avec des moments de calme après des temps d’excitation ;
- un cadre ferme mais bienveillant, sans cris ni menaces, mais avec des règles expliquées.
Cela ne signifie pas tout contrôler, mais donner de la lisibilité au quotidien.
Favoriser des stratégies de régulation
Avec le temps, l’enfant peut apprendre à :
- reconnaître les signes de montée émotionnelle (respiration rapide, crispation, etc.) ;
- utiliser des techniques simples de respiration, de pause, ou de retrait sensoriel (ex : se mettre au calme) ;
- exprimer ses besoins : « j’ai besoin de silence », « je préfère regarder plutôt que participer ».
L’accompagnement d’un psychologue spécialisé en développement de l’enfant peut être utile si l’enfant souffre de cette sensibilité ou s’il a du mal à trouver des repères dans ses relations sociales.
Soutenir les parents… et leur propre sensibilité
Il est essentiel de rappeler que de nombreux parents d’enfants hypersensibles sont eux-mêmes hypersensibles sans toujours le savoir2. Accompagner un enfant demande aussi de prendre soin de soi : s’informer, se faire accompagner par un.e professionnel.le de santé, partager avec d’autres parents peut aider à éviter l’épuisement parental. Ce soutien est précieux pour rester disponible émotionnellement tout en maintenant une posture éducative structurante.
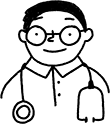
Le conseil du pédiatre
Le saviez-vous ? L’hypersensibilité serait présente chez 15-20%… Et ce n’est pas un trouble du comportement ni un facteur de fragilité…
L’accompagnement d’un enfant hypersensible repose sur trois piliers : écouter ses émotions sans les juger, lui offrir un cadre sécurisant, et l’aider à développer ses propres ressources d’adaptation. Si l’enfant souffre de son hypersensibilité ou si ses relations sont perturbées, n’hésitez pas à consulter un professionnel pour un soutien personnalisé.
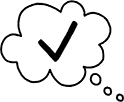
Je retiens !
Loin d’être un trouble ou un défaut, l’hypersensibilité est un mode de perception du monde plus fin, plus intense, plus empathique. Lorsqu’elle est comprise, respectée et valorisée, elle devient une ressource précieuse pour l’enfant et pour la société dans son ensemble. Accompagner un enfant hypersensible, c’est lui offrir les outils pour transformer ce trait en atout durable, au service de son épanouissement personnel, relationnel et professionnel.
Cet article vous a-t-il été utile ?
mpedia vous a aidé, aidez mpedia en faisant un don
Dernier don de Franck : 10 €
Comme Franck, soutenez une expertise indépendante et reconnue pour continuer à être un parent bien informé.
1Elaine N. Aron. Hypersensibles mieux se comprendre.
2Elaine N. Aron. The Highly Sensitive Person.
3Sylvie Portas. 2023. L’hypersensibilité chez l’enfant. Hypersensible et plein d’atouts !
4Kevin Hiridjee. « Hypersensibilité » : un mot fourre-tout ?
5Bianca P. Acevedo. Jadzia Jagiellowicz. E. Aron. Robert Marhenke. Sensory processing sensitivity and childhood quality’s effects on neural responses to emotional stimuli.
Francis Chateauraynaud et Josquin Debaz. Pages 5 à 33. Le partage de l’hypersensible : le surgissement des électrohypersensibles dans l’espace public.
Jean-Marc Scholl. Pages 109 à 130. Classification Diagnostique 0-3 ans Révisée : une nouvelle présentation des Troubles de la Régulation du traitement des stimuli sensoriels.
Note :
Les liens hypertextes menant vers d’autres sites ne sont pas mis à jour de façon continue. Il est donc possible qu’un lien devienne introuvable. Dans un tel cas, utilisez les outils de recherche pour retrouver l’information désirée.
Vous pouvez aussi être intéressé.e par :
-

TDAH chez l’enfant : symptômes, diagnostic et solutions pour mieux l’accompagner
-

TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme) ou autisme : repérer les signes d’alerte chez le bébé de moins de 3 ans
-

Anorexie mentale : comprendre ce trouble des conduites alimentaires
-

Causes et solutions à un comportement turbulent
-

Comment réagir face à l’agressivité persistante de mon enfant ?
-

Aider mon enfant à surmonter son stress pour l’école
Aucune question n’a été posée sur ce thème précis, vous pouvez poser la vôtre à nos experts.
Vous ne trouvez pas de réponse à votre question ?
Vous pouvez consulter les réponses déjà apportées par nos médecins à ce sujet en tapant votre question ou mots clés dans le moteur de recherche ci-dessous
Toujours pas de réponse ? Posez votre question à l'un de nos experts qui vous répondra rapidement.
Je pose ma questionPlus que 7 questions disponibles aujourd’hui









