Mis à jour le 01 septembre 2025 Dr Béatrice GUYARD BOILEAU
79% des parents ont trouvé cet article utile.

En France, la consommation d’alcool pendant la grossesse constitue un sujet de santé publique majeur. Depuis 2007, un logo d’avertissement figure sur les bouteilles et différentes campagnes de prévention sont régulièrement mises en place pour sensibiliser les futurs parents aux risques liés à l’exposition prénatale à l’alcool. Pourtant, environ 1 femme enceinte sur 10 déclare avoir consommé de l’alcool au cours de sa grossesse[1].
Or, l’alcool est la première cause de handicap non génétique et évitable chez l’enfant, regroupé sous le terme de Troubles du Spectre de l’Alcoolisation Fœtale (TSAF), ou parfois ETCAF (pour ensemble de troubles liés à l’alcoolisme fœtal)[1].
On ne connait pas de seuil de sécurité en termes de consommation d’alcool vis-à-vis du futur enfant ! La recommandation est donc zéro verre d’alcool pendant la grossesse. Mais pourquoi ? Quels sont les effets sur le fœtus et le développement de l’enfant ? Y a-t-il d’autres déterminants qui influencent la survenue de complications ?
Écouter l'article
0:00 / 0:00Sommaire de l'article
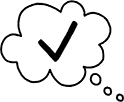
Je retiens !
Même à petite dose, l’alcool traverse le placenta et atteint le fœtus, dont l’organisme encore immature n’a pas la capacité de l’éliminer rapidement. Cela peut entraîner des effets sur la croissance, le développement cérébral ou les apprentissages, regroupés sous le terme de Troubles du Spectre de l’Alcoolisation Fœtale (TSAF) ou parfois ETCAF (pour ensemble de troubles liés à l’alcoolisme fœtal)[1].
Cependant, il est essentiel de rappeler que de nombreuses femmes découvrent leur grossesse après avoir consommé de l’alcool : cette situation est courante et n’entrainerait pas de conséquence… L’important est d’arrêter dès que la grossesse est connue, car chaque jour sans alcool réduit les risques et apporte un bénéfice réel pour la santé du bébé et de la maman.
Alcool et grossesse : pourquoi c’est dangereux ?
Le passage de l’alcool dans le sang et vers le fœtus
Lorsqu’une femme enceinte consomme de l’alcool, celui-ci passe rapidement dans son sang. Or, le placenta, qui assure les échanges entre la mère et le fœtus, ne constitue pas une barrière efficace contre l’alcool. En quelques minutes, le fœtus est exposé à une alcoolémie identique à celle de sa mère[2].
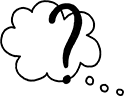
Le saviez-vous ?
Le fœtus ne dispose pas encore des capacités enzymatiques nécessaires pour éliminer l’alcool. Son foie est immature et l’alcool reste plus longtemps dans son organisme que chez l’adulte. Cette exposition prolongée accroît la toxicité et les effets sur son développement[2].
Par ailleurs, certaines caractéristiques génétiques chez la mère, comme le fœtus, font que l’alcool est plus lentement éliminé et/ou plus toxique chez certaines.
L’effet de l’alcool sur le développement cérébral
Le cerveau du fœtus est particulièrement vulnérable. L’alcool interfère avec plusieurs processus essentiels :
- la multiplication des cellules cérébrales,
- la migration des neurones vers leurs zones fonctionnelles,
- la formation des connexions entre les cellules nerveuses.
Ces perturbations peuvent avoir des conséquences irréversibles sur le système nerveux central et entraîner, selon l’intensité et la fréquence de l’exposition, des malformations, des troubles cognitifs, des difficultés d’apprentissage ou encore des troubles du comportement qui n’apparaîtront parfois que plus tard, à l’école ou à l’adolescence[2].
Ces troubles sont d’autant plus fréquents et plus graves que la consommation d’alcool est importante et fréquente. De plus, il est désormais démontré que les alcoolisations aiguës (forte consommation en peu de temps, par exemple lors d’une soirée) peuvent être particulièrement nocives pour le fœtus.
Les risques de la consommation d’alcool pendant la grossesse
Les effets immédiats sur la grossesse
Dès les premières semaines, la consommation d’alcool peut compliquer le déroulement de la grossesse. L’alcool augmente le risque de fausse couche spontanée (risque est multiplié par deux en cas de consommation importante ou d’alcoolisation aiguë). Par ailleurs, l’alcool peut perturber le développement de l’embryon et augmenter le risque de malformations.
Si la consommation se poursuit, le risque de retard de croissance in utero est augmenté, ainsi que celui d’accouchement prématuré, ce qui peut avoir des conséquences sur la santé du nouveau-né[2].
Le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF)
Le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) est la forme la plus sévère des troubles liés à l’exposition prénatale à l’alcool. Il a été décrit pour la première fois en 1973 et demeure aujourd’hui la première cause non génétique de handicap mental évitable chez l’enfant[4].
Le SAF touche environ 1 naissance sur 1 000 en France, mais les troubles liés à l’alcoolisation fœtale dans leur ensemble seraient jusqu’à 10 fois plus fréquents[4].
Il associe trois grands types de manifestations :
- des malformations physiques, notamment crâniofaciales (petite taille de la tête, anomalies des yeux et du philtrum, lèvre supérieure fine). Certaines anomalies peuvent être détectées à l’échographie ;
- des atteintes du système nerveux central, responsables de déficits intellectuels, de troubles de l’attention, d’hyperactivité ou de difficultés d’apprentissage ;
- des problèmes de croissance, de la vie in utero à l’enfance : le fœtus grandit moins vite et présente un poids de naissance plus faible. Ce retard s’installe souvent à partir du deuxième trimestre. Après la naissance, les enfants présentent souvent un poids et une taille inférieurs à la normale, parfois persistants à l’âge adulte.
Les Troubles du Spectre de l’Alcoolisation Fœtale (TSAF)
Au-delà du SAF, on parle plus largement de Troubles du Spectre de l’Alcoolisation Fœtale (TSAF). Cette notion englobe l’ensemble des conséquences possibles de l’exposition à l’alcool in utero, qu’elles apparaissent dès la naissance ou qu’elles se révèlent plus tard au cours de l’enfance. Les TSAF se manifestent de différentes manières. Ils peuvent entraîner des retards psychomoteurs, avec une acquisition plus tardive de la marche ou du langage et des difficultés à coordonner les gestes. Ils se traduisent aussi par des troubles cognitifs et scolaires, tels que des difficultés de lecture, d’écriture ou de calcul, souvent associés à une baisse du quotient intellectuel.
Sur le plan comportemental, les enfants peuvent présenter un déficit de l’attention, parfois accompagné d’hyperactivité, une impulsivité marquée ou encore des troubles de l’adaptation sociale. Dans certains cas, l’alcoolisation fœtale s’accompagne également de malformations cardiaques, cérébrales, squelettiques ou urogénitales.
Ces atteintes, qu’elles soient visibles ou plus discrètes, ne disparaissent pas avec l’âge. Elles persistent souvent à l’adolescence et à l’âge adulte. C’est pourquoi les TSAF constituent aujourd’hui un véritable enjeu de santé publique[4].
Alcool, grossesse et idées reçues
« Un verre de vin de temps en temps ce n’est pas grave » : une idée fausse
L’une des croyances les plus répandues est qu’une consommation occasionnelle, par exemple un verre de vin lors d’un repas de famille ou un verre de champagne lors d’une fête, ne présente pas de risque pour le bébé.
Or, il n’existe pas de quantité d’alcool sûre pendant la grossesse. Même à faible dose, l’alcool traverse le placenta et atteint le fœtus, dont le métabolisme est trop immature pour l’éliminer rapidement. Les effets varient d’une femme à l’autre et d’un fœtus à l’autre, ce qui rend impossible la définition d’un seuil de consommation « acceptable ». Ainsi, seule l’abstinence totale garantit l’absence de danger[1].
« J’ai bu avant de savoir que j’étais enceinte » : faut-il s’inquiéter ?
Une autre source d’angoisse fréquente concerne les femmes qui découvrent leur grossesse après avoir consommé de l’alcool. Cette situation est courante, et n’entrainerait pas de conséquence, même si on dispose de peu de données scientifiques solides pour répondre à cette question…
L’essentiel est d’arrêter immédiatement toute consommation dès que la grossesse est connue. Le suivi médical permettra d’évaluer la dépendance vis-à-vis de l’alcool, et d’accompagner la future mère de façon adaptée[1].
Prévenir et accompagner les femmes enceintes face à l’alcool
Les campagnes de prévention en France
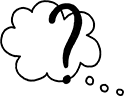
Le saviez-vous ?
C’est depuis 2007 que la présence obligatoire d’un pictogramme représentant une femme enceinte barrée sur les bouteilles rappelle que la consommation d’alcool est contre-indiquée durant la grossesse.
En parallèle, différentes actions de sensibilisation sont menées chaque année, comme la journée mondiale de Sensibilisation au Syndrome d’Alcoolisation Fœtale, organisée le 9 septembre. Ces campagnes visent à rappeler qu’aucun verre n’est sans risque, quelle que soit la boisson concernée, qu’il s’agisse de vin, de bière, de cidre ou de spiritueux.
Quand l’arrêt d’alcool est difficile
Pour certaines femmes, arrêter totalement l’alcool pendant la grossesse n’est pas simple, notamment lorsqu’il existe une dépendance ou une consommation ancienne et régulière. Dans ces cas, un accompagnement médical et psychologique est indispensable. Les professionnels de santé peuvent orienter vers des consultations spécialisées en addictologie, où un suivi adapté est mis en place. Il est préférable de s’engager vers l’arrêt avant même le projet de grossesse.
Des associations, comme SAF France ou la Fédération Addiction, proposent également un soutien et des ressources pour les femmes enceintes concernées. L’essentiel est de rappeler qu’il n’est jamais trop tard pour réduire ou cesser la consommation : chaque jour sans alcool représente un bénéfice pour la santé du bébé et de la mère.
Co-parent et entourage : ne pas inciter une femme enceinte à boire de l’alcool
Toute personne entourant une femme enceinte est invitée à ne pas l’inciter à boire de l’alcool, même de manière ponctuelle. Le co-parent est invité à modifier, si besoin, ses usages vis-à-vis de l’alcool.
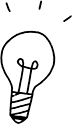
Pour aller plus loin
La naissance de l’enfant ne marque pas la fin des précautions vis-à-vis de l’alcool. Pendant l’allaitement, l’alcool consommé par la mère passe rapidement dans le lait maternel et se retrouve dans l’organisme du nourrisson. Comme chez le fœtus, son foie est encore immature, ce qui ralentit l’élimination de l’alcool.
Même de petites quantités peuvent donc perturber le bébé, provoquer des troubles du sommeil, des difficultés d’alimentation ou une somnolence inhabituelle.
Cet article vous a-t-il été utile ?
mpedia vous a aidé, aidez mpedia en faisant un don
Dernier don de Marie : 2 €
Comme Marie, soutenez une expertise indépendante et reconnue pour continuer à être un parent bien informé.
[1] Assurance Maladie. Zéro alcool de la conception à la fin de la grossesse.
[2] David Germanaud. Stéphanie Toutain. Exposition prénatale à l’alcool et troubles causés par l’alcoolisation fœtale.
[3] Agence Régionale de Santé. Grossesse et alcool : une consommation risquée pour la santé du fœtus.
[4] Association Vivre avec le SAF. Guide pour les parents et les aidants.
Institut national de santé publique du Québec. Alcool.
Note :
Les liens hypertextes menant vers d’autres sites ne sont pas mis à jour de façon continue. Il est donc possible qu’un lien devienne introuvable. Dans un tel cas, utilisez les outils de recherche pour retrouver l’information désirée.
Vous pouvez aussi être intéressé.e par :
-

Enceinte, je dis STOP aux excitants et aux toxines !
-

Quelles sont les conséquences de l’usage de drogues chez la femme enceinte ?
-

Sport enceinte : quelles activités sportives pratiquer pendant votre grossesse ?
-

Fumer enceinte : les risques du tabac pendant la grossesse
-

Hypertension artérielle, facteur de grossesses à risque
-

Diabète gestationnel : un risque à surveiller pendant la grossesse
Des conseils adaptés à l’âge de votre enfant !
Je m'abonne à la newsletter-
Alcool et grossesse : quels risques pour mon bébé ?
La réponse de l'expert
Bonjour, Vous posez une question complexe. Pour le citrate de Bétaine, pas de soucis. Un seul comprimé n’est pas nocif. Pour l’alcool: Déjà il y a un(...)
4 question de parents - la dernière il y a 3 semaines
-
J’ai bu de l’alcool sans savoir que j’étais enceinte, quels risques ?
La réponse de l'expert
Bonjour, Ce qui vous êtes arrivé n’est pas exceptionnel. Il y a des millions de femmes ayant consommées de l’alcool en tout début de grossesse avant d(...)
il y a 3 ans
-
Alcool début de grossesse, quel risque ?
La réponse de l'expert
Bonjour Madame, Déjà toutes nos félicitations pour votre grossesse. Vous posez une question assez complexe. Il y a une différence entre 6 verres d’un(...)
il y a 2 ans
-
J’ai consommé de l’alcool enceinte. Quels sont les risques ?
La réponse de l'expert
Bonjour, Soyez rassurée : déjà il y a une grande différence entre 3 verres de bière à 5cl et 3 verres à 2cl. La quantité d’alcool n’est pas du tout a (...)
il y a 2 ans
Vous ne trouvez pas de réponse à votre question ?
Vous pouvez consulter les réponses déjà apportées par nos médecins à ce sujet en tapant votre question ou mots clés dans le moteur de recherche ci-dessous
Toujours pas de réponse ? Posez votre question à l'un de nos experts qui vous répondra rapidement.
Je pose ma questionPlus que 9 questions disponibles aujourd’hui







