Mis à jour le 01 septembre 2025 Dr Béatrice GUYARD BOILEAU
91% des parents ont trouvé cet article utile.

Pendant la grossesse, le corps de la femme subit de nombreux bouleversements, en particulier hormonaux. Chez certaines futures mamans, ces changements peuvent entraîner une élévation anormale du taux de sucre dans le sang : c’est ce qu’on appelle le diabète gestationnel.
En France, tous les ans depuis 2021, on estime qu’une femme sur 6 environ est concernée[1].Comment se déroule le dépistage ? Quels sont les signes ou complications à surveiller ? Quels traitements suivre ?
Écouter l'article
0:00 / 0:00Sommaire de l'article
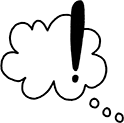
En bref
Le diabète gestationnel est un trouble fréquent, souvent silencieux, mais accessible à une prise en charge. Grâce à une alimentation équilibrée, l’activité physique, et si nécessaire, un traitement par insuline, la majorité des grossesses se déroulent sans complication.
Ce trouble transitoire ne s’arrête toutefois pas toujours à l’accouchement : il peut constituer les prémices d’un diabète chronique, d’où l’importance d’un suivi postnatal rigoureux pour les femmes concernées. Parler de son projet de grossesse avec son médecin ou sa sage-femme, connaître les facteurs de risque du dépistage, et réaliser les contrôles prescrits sont les meilleurs moyens de préserver sa santé et celle de son enfant.
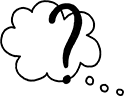
Le saviez-vous ?
Environ 16% des femmes enceintes en France sont concernées par le diabète gestationnel[1].
Le dépistage, réalisé chez les femmes à risque de diabète de la grossesse, même en l’absence de symptômes, est un outil essentiel de prévention, pour protéger la santé de la mère et du bébé.
Qu’est-ce que le diabète gestationnel ?
Définition et distinction avec les autres types de diabète
Le diabète gestationnel correspond à une augmentation du glucose (sucre) dans le sang, apparaissant pour la première fois pendant la grossesse. On utilise ce terme pour les femmes qui n’étaient néanmoins pas diabétiques avant d’être enceintes.
Ce type de diabète est différent :
- du diabète de type 1, maladie auto-immune dans laquelle le pancréas ne produit plus d’insuline,
- et du diabète de type 2, lié à une résistance progressive à l’insuline, souvent associé au surpoids ou à des antécédents familiaux.
Le diabète gestationnel est donc transitoire mais il est important de s’en occuper quand on est concerné, pour réduire la probabilité de certaines complications de la grossesse.
Prévalence et évolution en France
En France, le diabète gestationnel concerne environ 16 % des femmes enceintes. Cette proportion est en constante augmentation dans le temps, notamment en raison de l’évolution des modes de vie[1] : la sédentarité, l’augmentation du nombre de femmes en situation de surpoids ou d’obésité, ainsi que le report de l’âge de la maternité participent à cette augmentation d’année en année du nombre de femmes concernées.
À plus long terme, on recommande aux femmes ayant présenté du diabète gestationnel un suivi renforcé. En effet, près de la moitié des femmes ayant présenté un diabète gestationnel développeront un diabète de type 2 dans les 10 à 20 années suivant l’accouchement[2]. Un suivi régulier après la naissance est donc essentiel pour prévenir l’apparition d’un diabète chronique, ainsi que parfois de l’hypertension ou autres complications vasculaires.
Quels sont les facteurs de risque ?
Certaines femmes présentent un risque accru de développer un diabète gestationnel. Les principaux facteurs identifiés sont :
- des antécédents familiaux de diabète (parent au premier degré, frères ou sœurs) ;
- un surpoids ou une obésité (IMC supérieur ou égal à 25) ;
- un âge maternel supérieur ou égal à 35 ans ;
- des antécédents personnels de diabète gestationnel, ou de bébé macrosome à la naissance (généralement plus de 4 kg, mais parfois calculé selon le terme de naissance).
Le diabète de la grossesse, épisode 1 : c'est quoi ?
Afin de comprendre ce qu’il faut faire en cas de diabète gestationnel, vous pouvez regarder la vidéo « Le diabète de la grossesse, épisode 2 : quoi faire ? », réalisée par le Tuto’Tour de la Grossesse.
Le diabète de la grossesse, épisode 2 : quoi faire ?
Comment dépister le diabète gestationnel ?
À quel moment le dépistage a-t-il lieu ?
Le diabète gestationnel est souvent asymptomatique. C’est pourquoi un dépistage ciblé est recommandé au cours de la grossesse, en fonction des facteurs de risque identifiés. Il est généralement proposé
- une mesure de la glycémie à jeun au premier trimestre de la grossesse
- des analyses de sang au laboratoire entre la 24-ème et la 28-ème semaine d’aménorrhée, période clé où peuvent apparaitre les troubles de la régulation du sucre.
Quels sont les tests utilisés ?
Le dépistage repose sur 2 examens principaux permettant d’évaluer le taux de glucose dans le sang.
- La glycémie à jeun, prescrite tôt dans la grossesse, permet un premier repérage en cas d’anomalie.
- L’HGPO (Hyperglycémie provoquée par voie orale), également appelée test de charge en glucose, consiste à administrer 75 grammes de glucose par voie orale, puis à mesurer la glycémie à trois moments clés : à jeun, 1 heure et 2 heures après ingestion.
Ce test est aujourd’hui la méthode de référence recommandée par la Haute Autorité de Santé pour diagnostiquer un diabète gestationnel[2]. Un diagnostic est posé si l’une des valeurs suivantes est dépassée :
- glycémie à jeun ≥ 0,92 g/L,
- ou glycémie à 1 h ≥ 1,80 g/L,
- ou glycémie à 2 h ≥ 1,53 g/L.
Dans tous les cas, ces examens doivent être prescrits et interprétés par un professionnel de santé, généralement un médecin généraliste, une sage-femme ou un gynécologue-obstétricien.
Quelles sont les conséquences du diabète gestationnel ?
Pour la mère : un risque accru de complications obstétricales
Chez la femme enceinte, un diabète gestationnel mal contrôlé peut favoriser l’apparition de certaines complications pendant la grossesse et l’accouchement. On observe une augmentation du risque d’ hypertension artérielle gravidique, de césarienne, ou encore d’enfant macrosome à la naissance, c’est-à-dire que parmi les 5% des bébés les plus gros (par exemple plus de 3 700 grammes à 37 SA, ou plus de 3 900 grammes à 39 SA, ou plus de 4 500 grammes à 41 SA, soit à terme). Parfois on retient juste le poids de naissance de 4 000 grammes.
Par ailleurs, comme évoqué plus tôt, le diabète gestationnel est associé à un risque plus élevé de développer un diabète de type 2 dans les années qui suivent la naissance[2].
Pour le fœtus et le nouveau-né : des risques à la naissance
Lorsque la glycémie maternelle reste trop élevée, le fœtus y est exposé en permanence. Pour s’adapter, son pancréas se met à sécréter plus d’insuline, ce qui peut entraîner un excès de croissance intra-utérin (et on parle donc de macrosomie fœtale). Ce phénomène augmente les risques d’accouchement difficile (dystocie des épaules, césarienne).
À la naissance, le bébé sera surveillé pendant les premiers jours de vie, car parfois il peut présenter une chute du sucre dans le sang, appelé hypoglycémie. Il aura des contrôles, réalisés par une simple goutte de sang sur une bandelette. Dans certains cas extrêmes et heureusement rares où le diabète est très déséquilibré, le nouveau-né présente un peu plus souvent de l’ictère (jaunisse), ou des difficultés respiratoires transitoires (s’il nait un peu avant le terme en particulier), qui nécessitent parfois une surveillance en unité de néonatologie.
Pour en savoir davantage sur ce qu’il faut faire après un diabète gestationnel, vous pouvez regarder la vidéo « Après un diabète gestationnel, je reste attentive à ma santé ! », réalisée par le Tuto’Tour de la Grossesse.
Après un diabète gestationnel, je reste attentive à ma santé !
Quels sont les traitements du diabète gestationnel ?
Adapter son alimentation : la première étape du traitement
La diététique joue un rôle central dans le traitement du diabète gestationnel. La future maman aura des conseils et des explications sur un régime alimentaire adapté, visant à :
- éviter les sucres rapides (pâtisseries, sodas, sucreries…),
- répartir les apports en glucides tout au long de la journée,
- fractionner les repas (3 repas et 2 collations) pour éviter les pics de glycémie,
- et limiter la prise de poids excessive pendant la grossesse.
Ce régime doit être personnalisé, adapté aux besoins énergétiques de la mère et à la croissance du fœtus, sans entraîner de carences[4].
Par ailleurs, les femmes enceintes reçoivent des conseils pour mettre en place une activité physique régulière aérobie de fond (marche, vélo d’appartement, danse, natation, etc.).
Suivre sa glycémie au quotidien
En parallèle de l’alimentation, la femme enceinte doit mesurer régulièrement sa glycémie capillaire (méthode instantanée qui permet de mesurer le taux de sucre dans le sang) à l’aide d’un lecteur de glycémie (généralement 4 à 6 fois par jour). Ces mesures permettent de vérifier l’efficacité du régime et de décider, en lien avec l’équipe médicale, s’il est nécessaire d’introduire un traitement médicamenteux par l’insuline.
Le traitement par insuline, si le régime ne suffit pas
Si les glycémies restent au-dessus des seuils cibles malgré les mesures hygiéno-diététiques, un traitement par insuline sera prescrit. Ce traitement est le seul autorisé pendant la grossesse : les médicaments antidiabétiques oraux sont contre-indiqués car ils peuvent traverser le placenta.
L’insuline est injectée par la patiente elle-même, à l’aide de stylos adaptés, selon un schéma personnalisé. Ce traitement est sans danger pour le fœtus, car l’insuline ne passe pas dans la circulation sanguine du bébé. Il permet de maintenir un bon équilibre glycémique jusqu’à l’accouchement[5].
Parfois une proposition de déclenchement
Si les glycémies restent au-dessus des seuils cibles malgré la prise en charge, ou si le bébé est macrosome, un déclenchement est parfois proposé par l’équipe médicale. Ses bénéfices et son déroulement seront expliqués pas à pas.
Cet article vous a-t-il été utile ?
mpedia vous a aidé, aidez mpedia en faisant un don
Dernier don de Virginie : 10 €
Comme Virginie, soutenez une expertise indépendante et reconnue pour continuer à être un parent bien informé.
[1] Fédération Française des Diabétiques. Le diabète gestationnel.
[2] Haute Autorité de Santé. Rapport de synthèse sur le dépistage et le diagnostic du diabète gestationnel.
[3] Assurance Maladie. Comment dépiste-t-on un diabète gestationnel chez une femme enceinte ?
[4] Centre Hospitalier de Montréal. L’alimentation pour traiter le diabète de grossesse.
[5] Assurance Maladie. Diabète gestationnel : diététique, activité physique, insuline et surveillance.
Fédération Française des Diabétiques. Ma grossesse avec un diabète gestationnel.
Note :
Les liens hypertextes menant vers d’autres sites ne sont pas mis à jour de façon continue. Il est donc possible qu’un lien devienne introuvable. Dans un tel cas, utilisez les outils de recherche pour retrouver l’information désirée.
Vous pouvez aussi être intéressé.e par :
-

6ème mois, suivi de grossesse semaine après semaine
-

7ème mois, suivi de grossesse semaine après semaine
-

Principaux facteurs conduisant à des grossesses à risque
-

Diabète gestationnel : un risque à surveiller pendant la grossesse
-

Quelles sont les conséquences de l’usage de drogues chez la femme enceinte ?
-

Hypertension artérielle, facteur de grossesses à risque
Des conseils adaptés à l’âge de votre enfant !
Je m'abonne à la newsletterVous ne trouvez pas de réponse à votre question ?
Vous pouvez consulter les réponses déjà apportées par nos médecins à ce sujet en tapant votre question ou mots clés dans le moteur de recherche ci-dessous
Toujours pas de réponse ? Posez votre question à l'un de nos experts qui vous répondra rapidement.
Je pose ma questionPlus que 8 questions disponibles aujourd’hui









